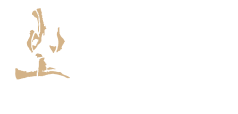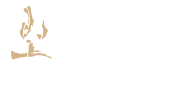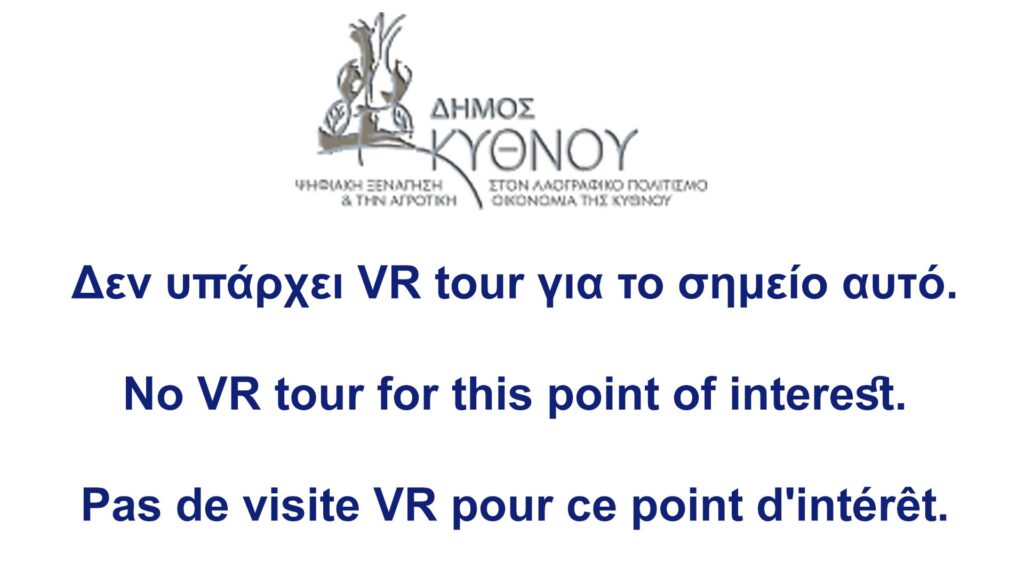Un des éléments caractéristiques du paysage rural de l’île de Kythnos ce sont les terrasses impressionnantes, lesdites skàles (escaliers) ou anavathmides ou pezoùles.
Au fil des siècles, les hommes aménageaient des terrasses afin de cultiver la terre et s’assurer leur alimentation. Les terrasses retiennent l’eau de pluie qui irrigue bien le sol et alimente l’aquifère avant d’aboutir à la mer en suivant les cours d’eau. Ainsi, les terrasses empêchent l’érosion du sol et ne lui permettent pas d’être emporté par l’eau.
Les terrasses sont aménagées à l’aide de la technique de la pierre sèche, c’est-à-dire, des murets en pierre qui servent à soutenir le sol.
Une partie non négligeable de cultures de l’île de Kythnos se déploie sur des terrasses, étant donné que les habitants de l’île ont toujours été très actifs dans le domaine de l’agriculture. Les étendues naturellement cultivables se trouvent aux estuaires, là où les vallées aboutissent à la mer, ainsi que sur le haut plateau de la Chora.
Les voyageurs qui se sont rendus dans les Cyclades décrivent Kythnos comme une terre très bien cultivée, permettant aux habitants de vivre en autarcie. La culture locale caractéristique qui dominait dans les terrasses était celle de l’orge. L’orge de Therma est un des plus importants produits agricoles de l’île et contribua à former l’histoire du pays. Sa culture était répandue et elle était le principal élément de l’alimentation des habitants. En outre, elle était particulièrement rentable, apportant des revenus à l’île grâce à l’exportation de l’excédent à la brasserie FIX, jusque dans les années 1970.
Ioannis Karolos Fix était le fondateur de la marque. Lorsqu’il décéda en 1922, il légua l’entreprise familiale à ses deux fils, Yiannis et Antonis, qui depuis leur plus jeune âge avaient appris le métier à ses côtés. Les frères développèrent l’entreprise et créèrent une malterie pour que la bière soit préparée à base d’orge grecque. À dos de mules et d’ânes, les producteurs transportaient les sacs d’orge vers les mouillages de l’île (Kanala, Episkopi, Agios Stefanos, Skylos, Gaïdouromantra, Agios Dimitris, FLampouria). Les sacs étaient pesés sur place et, ensuite, l’orge était déversée, en vrac, dans les caïques marchands qui le transportaient au Pirée.
Pour de nombreuses années, l’orge était une quasi-monoculture sur l’île. Mais, de nos jours, elle risque de disparaître en raison des exigences importantes qu’implique la production de l’orge. La principale étape de production est la moisson, c’est-à-dire, la tâche au cours de laquelle les agriculteurs fauchaient les gerbes mures et, ensuite, les transportaient à l’aire de battage pour en tirer les graines. La moisson était particulièrement importante puisqu’elle assurait le pain de la famille pour toute l’année. En même temps, elle était une tâche agricole pénible car elle exigeait que les hommes soient continuellement penchés, toute la journée, dans des conditions difficiles : au mois de juin, la température est déjà élevée. Femmes et hommes participaient à cette tâche, vêtus légèrement, de vêtements de couleur claire et à manches longues, pour être protégés contre la chaleur et les épines.
Le principal outil de la moisson était la faucille.Il s’agissait d’un outil tranchant, à couronne semi-circulaire en fer, fixée sur un manche en bois. La longueur de la couronne était d’environ 60 à 70 centimètres, large de 3 à 4 centimètres. La partie intérieure était dentée pour faciliter la coupe des gerbes. Le moissonneur saisissait plusieurs gerbes à l’aide de la faucille et, les retenant à la main, les coupait. Ensuite, il saisissait 2 à 3 de ces ensembles de gerbes, les tordait pour créer un bouquet qu’il liait pour que les gerbes ne soient pas dispersées. Ce bouquet de gerbes s’appelait cherià. Une autre façon de couper les gerbes, plus rapides que la cherià, était la coupe en cherovola (c’est-à-dire, la coupe de gerbes qui tenaient dans une seule main).
Lorsque la moisson était finie, on passait à la formation des paquets. Un paquet était composé d’environ 25 – 30 cherià ou 6 à 7 cherovola. Cette tâche était, elle aussi, exigeante : les paquets devaient être uniformes, impliquant que la coupe en cherià devait, elle aussi, être uniforme, sinon il était difficile de former les paquets et de les transporter. Les paquets étaient attachés un par un et laissés debout dans le champ, la gerbe vers le haut, jusqu’à ce qu’ils soient transportés à l’aire de battage. Les paquets posés autour de l’aire de battage formaient les meules. L’aire de battage était un espace circulaire et plat, recouvert de plaques de pierre, situé à un endroit où soufflaient des vents, principalement de vents d’ouest et nord. Avant d’entamer le battage, les hommes préparaient l’aire. On commençait par recouvrir les jointures entre les plaques qui recouvraient l’aire de battage, pour éviter que les graines ne soient perdues. On prenait donc de la terre argileuse, la mélangeait au fumier et créait une boue qui permettait de remplir toutes les jointures. Après quelques heures, cette boue était sèche et les jointures étaient couvertes. Ensuite, on vérifiait toutes les plaques et veillait à ce qu’elles soient bien fixées pour ne pas être déplacées lors du processus du battage. Une fois ces préparatifs achevés, on balayait minutieusement l’aire. Ainsi préparée, l’aire était prête pour entamer le battage. On jetait les paquets dans l’aire et un ou plusieurs animaux (mule, âne, bœuf) marchaient dessus pour extraire la graine.
D’ordinaire, après la moisson, les champs servaient de pâturage pour les moutons. La terre pouvait ainsi se reposer pour un an et être à nouveau cultivée l’année suivante.