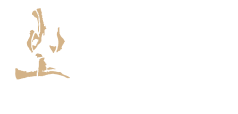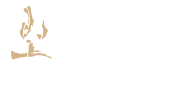Dans la Chora (chef-lieu) de Kythnos, l’on trouve une grande variété de cheminées. Cette variété est également due à la personnalité de chaque maître artisan qui réalise son travail en fonction de sa passion personnelle. Ainsi, le style a été transmis de génération en génération et chaque cheminée est une œuvre d’art. L’extrémité de la cheminée s’appelle kapassos et est, habituellement, un objet en terre cuite. D’ordinaire, elle présente une forme cylindrique avec un couronnement conique et des orifices d’où s’échappe la fumée. Ainsi, elle est un élément aussi bien fonctionnel que décoratif de l’habitation de Therma. Souvent, un kouroupi (vase en terre cuite) renversé, sans fond, ou bien une ruche en terre cuite servait de kapassos. Lorsque l’habitation devait rester vide pour une période prolongée, l’on scellait le kapassos en y posant une lourde pierre plate. Les kapassos les plus ouvragés sont constitués de jarres inversées dont le fond est conservé et d’où la fumée s’échappe par des ouvertures de formes diverses créées dans le corps de la jarre.
La cheminée n’est pas uniquement le tuyau par lequel s’échappe la fumée. Il s’agit également de l’espace que compose l’ensemble bâti et utilitaire du foyer où l’on prépare le repas. Le mot grec pour cheminée kaminada vient du grec kaminos qui signifie four ou fourneau, c’est-à-dire, la structure dans laquelle se développent des températures élevées. Le mot est également est également lié au mot vénitien caminada. La cheminée est habituellement aménagée à proximité d’un angle de l’habitation afin de faciliter la sortie de la fumée, indépendamment de la direction et de l’intensité du vent. L’on a constaté que la cheminée ne se trouve jamais en face de la porte, pour que le feu et la fumée ne soient pas affectés par le courant d’air. De l’intérieur, vers le haut, se forme un espace conique particulier qui, via la cheminée, aboutit au kapassos.
Les cheminées étaient construites pour répondre à des besoins fonctionnels de l’habitation rurale mais aussi urbaine de Kythnos. Elles étaient le prolongement naturel de l’espace de la cuisine et de la salle à manger, où l’on préparait le repas. La base du foyer de la cheminée est composée d’un plan surélevé, à environ 60 à 70 centimètres du plancher, et d’une superficie d’environ 1 à 2 mètres carrés, recouvert de plaques de pierre. Sur ce plan, l’on disposait la pyrostia, sur laquelle on posait la marmite en terre cuite, pour cuisiner. À côté, se trouve la foufou (version altérée du terme vénitien fogo), c’est-à-dire, le mangali, un foyer portable en terre cuite, à deux poignées, dans la partie inférieur duquel on plaçait le charbon. Les murs latéraux du foyer accueillent les divers ustensiles tels que le giouvetsi, la petite marmite à couvercle, la marmite to rovithio (des pois chiches) ainsi que le davas, pour la préparation de la viande de chèvre. Les outils nécessaires étaient la pince (massia) qui servait à repousser le bois et le charbon ardent.
Après 1950, l’on a arrêté de construire des cheminées dans les nouvelles habitations, puisque les repas étaient dorénavant préparés à l’aide de gaz de pétrole liquéfié et, plus tard, à l’aide de l’électricité.