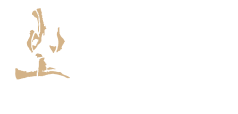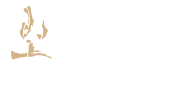Le moulin à vent Tziotaki est le mieux conservé et domine parmi les moulins à vent de Dryopida. Il a été construit vers 1910, en pierre, doté d’un toit conique en bois et haut d’environ 6 mètres. M. Antonis Vitalis, gendre de Tziotakis et dernier meunier, qui travailla là pour 14 ans, connaît tous les détails, comme il nous dit, « sur la construction, l’opération du moulin, jusqu’au dernier clou utilisé. Le moulin à vent est une usine en bois ».
Le moulin à vent, explique-t-il, est composé de trois niveaux. Au niveau inférieur, on stockait les céréales. Dans celui du milieu se trouvait le gouvernail et, au troisième, se trouvait l’arbre, long de 7 mètres, c’est-à-dire, le système de transmission du mouvement. C’est là que se trouvait le meunier, pour contrôler le gouvernail et déterminer la finesse de la farine qui serait produite, en déplaçant les meules.
Ce toit mobile tournant, connu comme troula, avec lequel est relié le mécanisme des ailes, dispose de 4 antennes, les madriers qui servaient à suspendre les entoilures, longs de 5 à 6 mètres. L’on y plaçait les entoilures pour compléter l’équipement. En fonction de la direction et de l’intensité du vent, le meunier corrigeait la position des entoilures et du toit, et garnissait ou dégarnissait les entoilures.
Les mylotopia (les sites à moulins à vent)
En règle générale, les moulins à vent se trouvaient autour de l’agglomération, réunis par groupes dans ce que l’on appelait les mylotopia. Ils ne suivent pas un trajet linéaire mais se trouvaient aux sommets des collines environnantes.La zone autour de chaque moulin devait être dégagée, pour ne pas empêcher le flux naturel du vent et que le front de mouture reste libre. Les moulins affectaient également le plan des zones bâties. En effet, il était nécessaire d’assurer des passages suffisamment larges, pour que puissent arriver les animaux chargés.
La bière… de Kythnos
L’orge de Kythnos était unique. Elle ne prospérait sur aucune autre île et était de qualité supérieure. Elle était produite en quantité suffisante pour l’île mais aussi pour être exportée dans le reste du pays. Jusqu’aux années 1970, la célèbre brasserie Fix rachetait la quasi-totalité de la production (près de 200 tonnes par an) de Kythnos, pour préparer ses bières. Au mois de septembre, les meuniers chargeaient les ânes de leurs sacs, tissés par leurs épouses, et les menaient aux ports de de l’époque (Kanala, Episkopi, Agios Stefanos, Skylos, Gaïdouromantra, Agios Dimitris, Flambouria) où les attendaient les bateaux qui les transportaient à Athènes.
Le meunier
La profession de meunier était fermée. En effet, le savoir-faire était exclusivement transmis de père en fils ou de beau-père à beau-fils. C’était un travail difficile et solitaire et exclusivement réservé aux hommes. Il exigeait une force musculaire importante, pour pouvoir mobiliser le toit contre le vent, soulever des poids mais aussi entretenir les meules propres.
Le travail commençait à 5 heures du matin et, fonction du temps, il pouvait se poursuivre jusqu’au soir. Par vent du Nord, qui était le vent idéal, il était possible de produire jusqu’à 50 kilos de farine par heure.
La rémunération du meunier était habituellement le 10 % de la production, c’est pourquoi il devait être minutieux et équitable dans ses transactions. Il veillait à ce que les farines de ses clients ne se mélangent pas, c’est pourquoi il les disposait séparément et les marquait. Le plus souvent, il chargeait lui-même les farines et les portait chez ses clients.